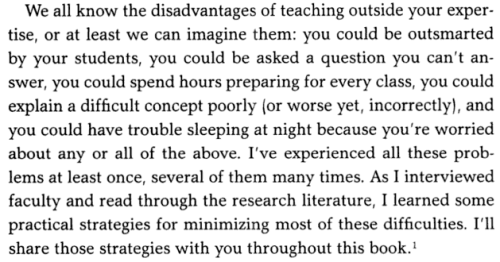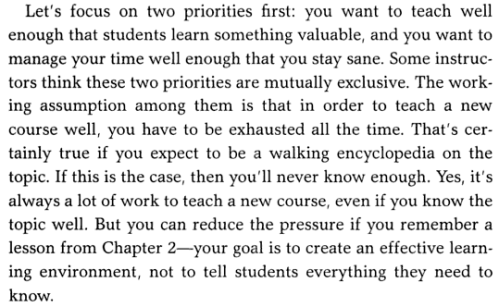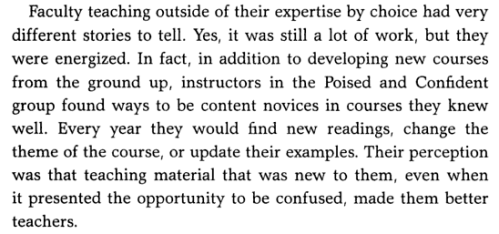Les livres de référence en pédagogie universitaire (et en français) sont plutôt rares si on compare avec la littérature sur la pédagogie de l’enseignement primaire et secondaire ou même avec le nombre de livres qui paraissent chaque année en pédagogie des adultes. Je parle ici des livres ou manuels introductifs à l’intention des enseignant-e-s du supérieur pour se former à l’enseignement. Personnellement, je les utilise régulièrement pour préparer des formations. Ceux qui me semblent les plus facilement abordables sont, par ordre alphabétique:
- Brauer, M. (2011). Enseigner à l’université. Conseils pratiques, astuces, méthodes pédagogiques. Paris: Armand Colin.
- Brown, G., & Atkins, M. (1987). Effective teaching in higher education. London: Methuen.
- Fry, H., Ketteridge, S., & Marshall, S. (Eds.). (2003). A handbook for teaching and learning in higher education. Enhancing academic practice. (2nd ed.). London: Routledge-Falmer.
- Gibbs, G., & Habeshaw, T. (2001). Preparing to teach. An introduction to effective teaching in higher education (5th ed.). Wiltshire, UK: The Cromwell Press.
- Prégent, R., Bernard, H., & Kozanitis, A. (2009). Enseigner à l’université dans une approche-programme. Montréal: Presses internationales Polytechnique.
- Ramsden, P. (2003). Learning to Teach in Higher Education. New-York: Routledge.
- Svinicki, M., & McKeachie, W. J. (Eds.). (2011). McKeachie’s teaching tips. Strategies, research, and theory for college and university teachers (13th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
Parmi ces ouvrages, seulement deux sont en français. Mais depuis moins d’un mois, je peux y ajouter un troisième:
Berthiaume, D., & Rege Colet, N. (Eds.). (2013). La pédagogie de l’enseignement supérieur: repères théoriques et applications pratiques (Vol. 1). Berne: Peter Lang.
Il s’agit d’un livre collectif auquel ont participé 12 conseiller/ère-s pédagogiques et enseignant-e-s/chercheur-euse-s spécialisé-e-s dans l’enseignement supérieur. J’ai pu participer avec mes collègues à l’écriture de plusieurs des 20 chapitres qui composent cet ouvrage.
Pour situer l’intention générale du livre, voici quelques extraits de l’introduction (pages 2-3):
Le rôle de l’enseignant du supérieur a donc passablement évolué depuis les années 80. Ce rôle n’est plus de simplement exposer des notions reliées à son domaine d’expertise mais plutôt de concevoir des situations d’apprentissage lors desquelles les étudiants sont amenés à réfléchir aux notions présentées, à les utiliser, de façon à se les approprier. S’il était possible pour un professionnel et/ou un chercheur sans formation pédagogique de s’y retrouver dans un contexte d’enseignement « transmissif », la situation est beaucoup plus difficile dans un contexte où son rôle est d’accompagner l’apprentissage des étudiants. La tâche n’est définitivement pas la même!
Alors, comment aider les enseignants du supérieur à se développer au titre de professionnels de l’enseignement, parallèlement à leur développement dans leur domaine de spécialisation? Depuis les années 70, bon nombre d’institutions d’enseignement supérieur ont mis en place une structure de pédagogie (par exemple, centre de soutien à l’enseignement, centre d’innovation pédagogique, service de développement académique, service pédagogique ou didactique) visant à accompagner les enseignants dans leur développement. Ces structures organisent divers types d’activités allant de l’atelier de formation au conseil individuel, en passant par l’évaluation des enseignements par les étudiants ou la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage. La logique d’intervention est rarement directive et certificative. Dans la plupart des cas, il s’agit de mettre à disposition des enseignants des ressources – humaines, documentaires, financières – pour les aider à se développer selon leurs propres besoins et aspirations. Comme tout professionnel, l’enseignant du supérieur se développe au fur et à mesure que se déroule sa carrière. Ce développement s’effectue par l’entremise de questionnements, d’explorations, de découvertes, de réussites et, parfois, d’échecs. Mais encore faut-il que l’environnement dans lequel oeuvre cet enseignant l’encourage à se développer… […]
C’est donc pour venir en aide aux enseignants du supérieur qui se posent des questions et qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans le domaine de la pédagogie de l’enseignement supérieur que nous avons développé le présent ouvrage. Nous souhaitions mettre à disposition de ces enseignants des ressources leur permettant de développer leurs compétences pédagogiques au moment où ils choisiraient de le faire et selon un rythme qui leur sera propre.
La table des matières est présentée sur le site de l’éditeur. Chaque chapitre commence par un cas pratique: un-e enseignant-e se pose une question ou est confronté-e à un problème pédagogique avec ses étudiant-e-s. Ensuite, en articulant éléments théoriques et exemples pratiques, les auteur-e-s proposent de répondre à cette question. Enfin, deux encarts synthétiques closent chaque chapitre, l’un pour les enseignant-e-s et l’autre à l’intention des conseiller/ère-s pédagogiques.
J’espère que ce livre trouvera sa place dans les institutions d’enseignement supérieur, que ce soit dans le bureau des enseignant-e-s ou celui des conseiller/ère-s! Un tome 2 est en préparation et se centrera sur le développement professionnel des enseignant-e-s du supérieur.